Reforma Educativa

Radical Politics in the Age of American Authoritarianism: Connecting the Dots
The United States stands at the endpoint of a long series of attacks on democracy, and the choices faced by many in the US today point to the divide between those who are and those who are not willing to commit to democracy. Debates over whether Donald Trump is a fascist are a tactical diversion because the real issue is what it will take to prevent the United States from sliding further into a distinctive form of authoritarianism.
The willingness of contemporary politicians and pundits to use totalitarian themes echoes alarmingly fascist and totalitarian elements of the past. This willingness also prefigures the emergence of a distinctive mode of authoritarianism that threatens to further foreclose venues for social justice and civil rights. The need for resistance has become urgent. The struggle is not over specific institutions such as higher education or so-called democratic procedures such as elections but over what it means to get to the root of the problems facing the United States and to draw more people into subversive actions modeled after both historical struggles from the days of the underground railroad and contemporary movements for economic, social and environmental justice.
If progressives are to join in the fight against authoritarianism in the US, we all need to connect issues.
Yet, such struggles will only succeed if more progressives embrace an expansive understanding of politics, not fixating singularly on elections or any other issue but rather emphasizing the connections among diverse social movements. An expansive understanding such as this necessarily links the calls for a living wage and environment justice to calls for access to quality health care and the elimination of the conditions fostering assaults by the state against Black people, immigrants, workers and women. The movement against mass incarceration and capital punishment cannot be separated from a movement for racial justice; full employment; free, quality health care and housing. Such analyses also suggest the merging of labor unions and social movements, and the development of progressive cultural apparatuses such as alternative media, think tanks and social services for those marginalized by race, class and ethnicity. These alternative apparatuses must also embrace those who are angry with existing political parties and casino capitalism but who lack a critical frame of reference for understanding the conditions for their anger.
What is imperative in rethinking the space of the political is the need to reach across specific identities and stop mobilizing exclusively around single-issue movements and their specific agendas. As the Fifteenth Street Manifesto Group expressed in its 2008 piece, «Left Turn: An Open Letter to US Radicals,» many groups on the left would grow stronger if they were to «perceive and refocus their struggles as part of a larger movement for social transformation.» Our political agenda must merge the pedagogical and the political by employing a language and mode of analysis that resonates with people’s needs while making social change a crucial element of the political and public imagination. At the same time, any politics that is going to take real change seriously must be highly critical of any reformist politics that does not include both a change of consciousness and structural change.
If progressives are to join in the fight against authoritarianism in the United States, we all need to connect issues, bring together diverse social movements and produce long-term organizations that can provide a view of the future that does not simply mimic the present. This requires connecting private issues to broader structural and systemic problems both at home and abroad. This is where matters of translation become crucial in developing broader ideological struggles and in fashioning a more comprehensive notion of politics.
There has never been a more pressing time to rethink the meaning of politics, justice, struggle and collective action.
Struggles that take place in particular contexts must also be connected to similar efforts at home and abroad. For instance, the ongoing privatization of public goods such as schools can be analyzed within the context of increasing attempts on the part of billionaires to eliminate the social state and gain control over commanding economic and cultural institutions in the United States. At the same time, the modeling of schools after prisons can be connected to the ongoing criminalization of a wide range of everyday behaviors and the rise of the punishing state. Moreover, such issues in the United States can be connected to other authoritarian societies that are following a comparable script of widespread repression. For instance, it is crucial to think about what racialized police violence in the United States has in common with violence waged by authoritarian states such as Egypt against Muslim protesters. This allows us to understand various social problems globally so as to make it easier to develop political formations that connect such diverse social justice struggles across national borders. It also helps us to understand, name and make visible the diverse authoritarian policies and practices that point to the parameters of a totalitarian society.
There has never been a more pressing time to rethink the meaning of politics, justice, struggle, collective action, and the development of new political parties and social movements. The ongoing violence against Black youth, the impending ecological crisis, the use of prisons to warehouse people who represent social problems, and the ongoing war on women’s reproductive rights, among other crises, demand a new language for developing modes of creative long-term resistance, a wider understanding of politics, and a new urgency to create modes of collective struggles rooted in more enduring and unified political formations. The American public needs a new discourse to resuscitate historical memories and methods of resistance to address the connections between the escalating destabilization of the earth’s biosphere, impoverishment, inequality, police violence, mass incarceration, corporate crime and the poisoning of low-income communities.
Not only are social movements from below needed, but also there is a need to merge diverse single-issue movements that range from calls for racial justice to calls for economic fairness. Of course, there are significant examples of this in the Black Lives Matter movement (as discussed by Alicia Garza, Keeanga-Yamahtta Taylor andElizabeth Day) and the ongoing strikes by workers for a living wage. But these are only the beginning of what is needed to contest the ideology and supporting apparatuses of neoliberal capitalism.
The call for broader social movements and a more comprehensive understanding of politics is necessary in order to connect the dots between, for instance, police brutality and mass incarceration, on the one hand, and the diverse crises producing massive poverty, the destruction of the welfare state and the assaults on the environment, workers, young people and women. As Peter Bohmer observes, the call for a meaningful living wage and full employment cannot be separated from demands «for access to quality education, affordable and quality housing and medical care, for quality child care, for reproductive rights and for clean air, drinkable water,» and an end to the pillaging of the environment by the ultra-rich and mega corporations. He rightly argues:
Connecting issues and social movements and organizations to each other has the potential to build a powerful movement of movements that is stronger than any of its individual parts. This means educating ourselves and in our groups about these issues and their causes and their interconnection.
In this instance, making the political more pedagogical becomes central to any viable notion of politics. That is, if the ideals and practices of democratic governance are not to be lost, we all need to continue producing the critical formative cultures capable of building new social, collective and political institutions that can both fight against the impending authoritarianism in the United States and imagine a society in which democracy is viewed no longer as a remnant of the past but rather as an ideal that is worthy of continuous struggle. It is also crucial for such struggles to cross national boundaries in order to develop global alliances.
Democracy must be written back into the script of everyday life.
At the root of this notion of developing a comprehensive view of politics is the need for educating ourselves by developing a critical formative culture along with corresponding institutions that promote a form of permanent criticism against all elements of oppression and unaccountable power. One important task of emancipation is to fight the dominant culture industry by developing alternative public spheres and educational institutions capable of nourishing critical thought and action. The time has come for educators, artists, workers, young people and others to push forward a new form of politics in which public values, trust and compassion trump neoliberalism’s celebration of self-interest, the ruthless accumulation of capital, the survival-of-the-fittest ethos and the financialization and market-driven corruption of the political system. Political responsibility is more than a challenge — it is the projection of a possibility in which new modes of identification and agents must be enabled that can sustain new political organizations and transnational anti-capitalist movements. Democracy must be written back into the script of everyday life, and doing so demands overcoming the current crisis of memory, agency and politics by collectively struggling for a new form of politics in which matters of justice, equity and inclusion define what is possible.
Such struggles demand an increasingly broad-based commitment to a new kind of activism. As Robin D. G. Kelley has recently noted, there is a need for more pedagogical, cultural and social spaces that allow us to think and act together, to take risks and to get to the roots of the conditions that are submerging the United States into a new form of authoritarianism wrapped in the flag, the dollar sign and the cross. Kelley is right in calling for a politics that places justice at its core, one that takes seriously what it means to be an individual and social agent while engaging in collective struggles. We don’t need tepid calls for repairing the system; instead, we need to invent a new system from the ashes of one that is terminally broken. We don’t need calls for moral uplift or personal responsibility. We need calls for economic, political, gender and racial justice. Such a politics must be rooted in particular demands, be open to direct action and take seriously strategies designed to both educate a wider public and mobilize them to seize power.
The left needs a new political conversation that encompasses memories of freedom and resistance. Such a dialogue would build on the militancy of the labor strikes of the 1930s, the civil rights movements of the 1950s and the struggle for participatory democracy by the New Left in the 1960s. At the same time, there is a need to reclaim the radical imagination and to infuse it with a spirited battle for an independent politics that regards a radical democracy as part of a never-ending struggle.
None of this can happen unless progressives understand education as a political and moral practice crucial to creating new forms of agency, mobilizing a desire for change and providing a language that underwrites the capacity to think, speak and act so as to challenge the sexist, racist, economic and political grammars of suffering produced by the new authoritarianism.
The left needs a language of critique that enables people to ask questions that appear unspeakable within the existing vocabularies of oppression. We also need a language of hope that is firmly aware of the ideological and structural obstacles that are undermining democracy. We need a language that reframes our activist politics as a creative act that responds to the promises and possibilities of a radical democracy.
Movements require time to mature and come into fruition. They necessitate educated agents able to connect structural conditions of oppression to the oppressive cultural apparatuses that legitimate, persuade, and shape individual and collective attitudes in the service of oppressive ideas and values. Under such conditions, radical ideas can be connected to action once diverse groups recognize the need to take control of the political, economic and cultural conditions that shape their worldviews, exploit their labor, control their communities, appropriate their resources, and undermine their dignity and lives. Raising consciousness alone will not change authoritarian societies, but it does provide the foundation for making oppression visible and for developing from below what Étienne Balibar calls «practices of resistance and solidarity.» We need not only a radical critique of capitalism, racism and other forms of oppression, but also a critical formative culture and cultural politics that inspire, energize and provide elements of a transformative radical education in the service of a broad-based democratic liberation movement.
May not be reprinted without permission of the author

Croire en une conscience féministe unique est dépassé
AURÉLIE LEROY
Une frange du mouvement féministe occidental continue de penser que ses mots d’ordre et ses méthodes d’action valent, sans distinctions ni nuances, pour l’ensemble des continents — au point que la notion même de « féminisme » soit parfois perçue, dans « le Sud », comme une énième tentative d’intrusion du « Nord ». A paru à la fin de l’année 2015 l’ouvrage collectif État des résistances dans le Sud — Mouvements de femmes, coédité par le Centre Tricontinental et Syllepses. L’historienne Aurélie Leroy en est la coordinatrice. « Les féminismes s’inventent, se pratiquent, mais ne se ressemblent pas », avance cet ouvrage qui conduit ses lecteurs du Sénégal au Sri Lanka, en passant par le Chili, l’Irak, le Mexique et la Chine. De quelle manière ces pensées et ces pratiques, peu connues dans nos pays, permettent-elles de secouer les angles morts, de sortir des pistes dominantes et d’œuvrer, au final, à l’émancipation de toutes les femmes ?
Un fil rouge paraît traverser cet ouvrage : il n’y a pas de féminisme unique et monolithique. Est-ce une réalité entendue, désormais, ou faut-il encore lutter pour la faire accepter ?
Il y a des vérités qu’il est bon de dire et de répéter, quitte à parfois donner l’impression de taper sur le clou. Affirmer que les luttes féministes sont plurielles et qu’il n’existe pas une vision monolithique du féminisme n’est pas neuf. Du chemin a été parcouru depuis le « Sisterhood is powerful » des années 1970. Cette idée d’une « condition partagée » a été démontée par une génération de féministes — qualifiée de troisième vague — au sein de laquelle les femmes du Sud ont joué un rôle moteur. Elles ont mis en exergue les différences qui existaient entre les femmes et insisté sur l’imbrication des rapports de pouvoir. Le sexisme ne fonctionne pas en vase clos et s’articule avec d’autres formes d’oppression comme les discriminations sur la base de la race, la classe, l’orientation sexuelle, la génération, etc. Croire en une conscience féministe unique et unifiée est aujourd’hui dépassé, mais en dépit de cette évidence, la tentation de l’universalisation du féminisme perdure. L’activisme déshabillé des Femen en est une expression. S’appuyant sur leur propre expérience de l’émancipation, leurs membres entendent imposer leur conception à d’autres — à la manière d’un « copier/coller » — et libérer les femmes en leur dictant ce qui est « bon » et « vrai ». Un militantisme aux relents néo-coloniaux douteux …
Les rapports Nord / Sud sont au cœur des propos défendus par les auteures. Vous évoquez la « violence » et la « douleur » qu’un féminisme occidental, blanc, urbain et hégémonique a pu, ici et là, susciter : qu’en est-il ?
Les Femen, une fois encore, en ayant pour cible favorite les femmes musulmanes et en les présentant comme des victimes passives enfermées dans la tradition et aux mains d’hommes par nature oppressifs, adoptent une posture condescendante et arrogante empreinte de racisme. En se « libérant » de leurs vêtements, elles s’érigent comme des actrices éclairées, modernes et libérées face à des femmes musulmanes dont le voilement est perçu à leurs yeux comme un signe nécessairement oppressif qu’il faut combattre. En projetant leurs attentes sur des réalités extérieures qui leur sont inconnues, les Femen ont cristallisé les tensions et jeté le discrédit sur les combats féministes, déjà parfois perçus comme ayant une forte référence occidentale et une optique utilitariste. Les exemples d’instrumentalisation de leurs causes sont en effet malheureusement légion. L’intervention en Afghanistan au nom de la défense des droits des femmes, la manipulation du féminisme à des fins racistes en Europe (les « événements de Cologne », la « criminalité étrangère », « l’intégration des immigré(e)s », les polémiques sur le voile, etc.), la conditionnalité des aides étrangères à l’intérieur d’un cadre de référence marqué par le féminisme libéral et le capitalisme occidental sont autant de situations qui ont été vécues (in)directement et douloureusement par les femmes dans leurs territoires et dans leurs corps.
Dans l’un des textes, signé par des féministes colombiennes, il est dit que ce féminisme extra-occidental permet « d’enrichir la perspective féministe ». Quels sont ses principaux apports ?
Le féminisme est un double mouvement. Un mouvement social qui s’est construit sur le terrain des luttes, mais aussi un mouvement intellectuel qui s’intéresse aux rapports sociaux de sexe, aux relations qui lient et opposent les sexes, aux facteurs qui déterminent la subordination sociale des femmes. Une telle approche permet de réfléchir aux causes de la relation d’oppression, mais aussi aux moyens d’y mettre fin. Les femmes des « multiples Suds » ont agi à ces deux niveaux : celui de la réflexion et de l’action. Elles ont apporté, à partir de leurs expériences diversifiées, une compréhension fine et nuancée des logiques de pouvoir à l’œuvre et affirmé leur volonté d’être parties prenantes dans l’élaboration de la pensée et des luttes féministes (non pas pour « suivre » le mouvement, mais pour le « recomposer »). Elles ont affirmé l’importance de prendre en compte l’articulation de différents systèmes d’oppression, des complexités socio-historiques, et de ne pas sous-estimer les structures de pouvoir productrices d’inégalités comme le (néo)colonialisme et le néolibéralisme. Sur cette base, elles ont rappelé que les voies de l’émancipation ne sont pas prédéfinies et sont donc — encore et toujours — à (ré)inventer. L’espace domestique et familial n’est ainsi pas nécessairement à l’origine de l’asservissement des femmes, pas plus que la religion contraire au projet d’émancipation. Les apports des féminismes des Suds permettent de dépasser certaines conceptions binaires réductrices et de repenser les relations entre féminisme et religion, entre espace public et privé, entre tradition et modernité, entre « homme dominateur » et « femme subordonnée », etc.
Christine Delphy a souvent dénoncé l’instrumentalisation du féminisme à des fins impériales (on se souvient de son article « Une guerre pour les femmes afghanes ? ») et la question (post)coloniale revient régulièrement dans les arguments de ces nombreuses féministes : comment, pour reprendre la formule de la sociologue Zahra Ali, se lient « les questions de genre, de nation et d’impérialisme » ?
Le rapport que les féministes d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine entretiennent avec l’Occident est parfois tendu. Cela tient en partie au fait que, dans de nombreux pays du Sud, les mouvements féministes ont affirmé à l’origine leur militantisme au travers des luttes de libération nationale et l’ont par la suite inscrit dans une critique de la domination impérialiste sous ses multiples formes. En Haïti, l’histoire politique du pays a été marquée par les résistances des femmes, que ce soit contre l’occupation états-unienne, les coups d’État ou les interventions militaires étrangères. Dans le chaos de la reconstruction post-séisme de 2010 et dans le contexte actuel de crise politique — le pays est sans président — les organisations féministes et de femmes haïtiennes dénoncent le rôle joué par les États-Unis, l’Union européenne et les acteurs humanitaires et internationaux qui « participent plus du problème que de la solution ». Elles défendent avec d’autres acteurs sociaux « l’exigence d’une souveraineté populaire » (Thomas, 2016) et veulent en finir avec la dépendance politique et économique. Elles revendiquent la mise en place d’un pouvoir démocratique qui se détache du modèle de développement injuste et incohérent actuel, mais sans que soient occultées les violences et les inégalités produites par une société machiste. Que ce soit en Haïti ou en Afghanistan, l’espoir d’un changement en faveur des femmes ne peut reposer sur des ambitions affichées par une force étrangère. Le renforcement des rôles politiques et publics des femmes afghanes, voulu par les agences d’aide étrangère, a ainsi échoué et a constitué une cible facile pour les groupes conservateurs attachés au statu quo en matière de genre.
La dimension religieuse est évoquée – en particulier dans le chapitre consacré au monde arabe. Il est même question d’un « féminisme islamique », c’est-à-dire d’une émancipation conçue de l’intérieur d’une tradition spirituelle. Le ménage entre émancipation des femmes et monothéisme (par nature peu favorable aux femmes) heurte toutefois plus d’un.e féministe – en France, particulièrement. De quelle manière aborder cette crispation ?
La France, plus encore que la Belgique, s’est posée en « protectrice de la laïcité » au nom des droits des femmes, avec une crispation des débats autour de la question du voile. La laïcité est devenue un marqueur déterminant de la nation, qui lui fait penser le droit des femmes au travers elle. Dans d’autres contextes où la religion est à l’inverse un référent culturel et identitaire majeur, des militantes ont compris la nécessité de composer avec celui-ci pour rendre audible leur revendication égalitaire, mais sans pour autant abandonner le cadre universaliste des droits humains ! Des chercheuses et militantes se sont ainsi engagées dans une démarche féministe à l’intérieur du cadre religieux musulman, démontrant ainsi la compatibilité entre féminismes et islam. Pour tous ceux qui seraient dubitatifs ou farouchement hostiles à ce rapprochement, j’aimerais insister sur deux éléments inspirés des réflexions de ces féministes. Le premier, c’est l’effet du « deux poids, deux mesures ». Plus que dans les autres religions monothéistes, les femmes musulmanes sont désignées et définies par le prisme de la religion. L’islam expliquerait tout, notamment leurs conditions de vie et leur inégal statut. S’il est indispensable de combattre le caractère patriarcal et oppressif des religions, il est crucial aussi de ne pas tomber dans le piège des préjugés ou dans l’instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. Les événements de Cologne sont là pour nous le rappeler. Les appels à la défense de « nos femmes », entendus chez plusieurs politiciens et journalistes, doivent être rejetés à la fois pour leur caractère xénophobe, mais aussi car ils court-circuitent le débat, banalisant ou marginalisant la problématique des violences faites aux femmes. La seconde idée, dans la foulée de l’exemple de Cologne, c’est le détournement ou l’occultation de certains débats. À force de se concentrer sur la misogynie des religions, on en oublierait presque que « le » monde musulman est en fait « les » des mondes musulmans. Et que cet ensemble de pays, qui s’étend sur plusieurs continents, connaît des langues et des cultures différentes, et qu’il est profondément marqué par des facteurs historiques et socio-économiques qui agissent de manière déterminante sur la manière dont vivent les femmes et dont elles sont perçues par la société. Croire que « pour comprendre les musulmans, il suffirait de lire le Coran » est un raccourci réducteur, comme nous le rappelle Zahra Ali.
La question de l’universalisme sous-tend tout cela. Comment trouver un juste point d’équilibre entre un relativisme culturel délétère et un universalisme orgueilleux et dominateur ?
Les féministes postcoloniales, notamment, se sont distanciées des conceptions universalistes et hégémoniques du patriarcat, étant fondées sur les expériences et besoins des femmes blanches, urbaines, hétérosexuelles, issues de la classe moyenne. En s’inscrivant dans un contexte et en adoptant un point de vue historiquement situé, elles ont rejeté l’universalisme féministe porté par certaines intellectuelles. Cette attention portée au respect de la différence comportait toutefois le risque de basculer dans une sorte de « fondamentalisme culturel », qui se serait opposé à toute tentative de transformation des pratiques qui affectent la vie des femmes au nom de la préservation de l’identité du groupe. Ici encore, en historicisant des pratiques culturelles comme la polygamie ou le sati (l’immolation des veuves), les féministes du Sud se sont attachées à faire évoluer des traditions qui sont source de violence à l’égard des femmes. En Indonésie, des militantes musulmanes¹ ont insisté sur le fait que les textes fondamentaux ont été écrits à une époque différente et dans des conditions qui ne prévalent plus actuellement. Au temps du Prophète, les guerres étaient omniprésentes et de nombreuses femmes se sont retrouvées seules. Dans ces circonstances sociohistoriques, les mariages polygamiques étaient courants. Si cette pratique s’explique dans un contexte donné, lutter aujourd’hui pour que la polygamie disparaisse ne constitue pas une menace pour l’intégrité identitaire du groupe.
Le terme même de « féminisme » n’est pas toujours mis en avant, de la part de militantes pour le droit des femmes (l’ouvrage rappelle aussi qu’il n’existe pas au Congo et qu’il est ambigu en Chine). Que révèle le poids de ce mot – qui n’est, bien sûr, absolument pas intégré non plus dans l’imaginaire collectif franco-belge ?
Dans les pays du Sud, il n’est pas rare que des organisations ou des femmes refusent d’endosser l’identité politique féministe. Le terme est parfois perçu comme étranger et imposé de l’extérieur, et l’agenda des militantes du Nord ne semble pas toujours coller à celui des femmes du Sud. Le « non » à la cause féministe n’est toutefois pas un « non » à des revendications égalitaires, mais un « non » au lieu de pouvoir que représente l’Occident et un refus de l’instrumentalisation du féminisme. En Europe, le féminisme est loin aussi de faire l’unanimité, mais pour d’autres raisons. Il est attaché à de nombreux stéréotypes au point que beaucoup hésitent avant de s’en réclamer. Le féminisme serait dépassé et hors de propos dans nos sociétés prétendument égalitaires. Il renverrait à l’idée de guerre des sexes, menée par des femmes agressives et frustrées qui se voudraient anti-homme, anti-sexe et anti-amusement. « Il y a pire ailleurs » ou « il y a des combats plus importants » ou « il ne faut pas nier les évidences naturelles » sont quelques-unes des petites phrases assassines qui participent au travail de sape des revendications féministes. Et pourtant, les discriminations sexistes se poursuivent ici comme ailleurs, en particulier dans le champ du travail. En matière de violence, une femme sur trois a subi une forme de violence physique ou sexuelle dans l’Union européenne depuis l’âge de 15 ans. La « culture du viol » et l’idée de pouvoir disposer librement du corps des femmes sont une réalité sous nos latitudes. Le « réflexe » est d’apprendre à nos filles à se protéger (ne pas boire, ne pas s’habiller de manière provocante, ne pas sortir tard et/ou seule, etc.) pendant qu’apparemment il n’y aurait rien à enseigner à nos garçons… L’évocation du viol est omniprésente dans la vie des femmes, quasi absente dans celle des hommes. Une réalité, l’égalité homme-femme ? Ne nous voilons pas la face !
L’une des riches contributions du livre est celle de la féministe mexicaine Claudia Korol : elle propose un « féminisme de parole-action » ancré dans les luttes socialistes et antilibérales – un « féminisme populaire » et non libéral et minoritaire. Au Bahreïn, explique Sawsan Karimi, le féminisme n’intéresse « qu’une minorité de femmes issues de l’intelligentsia ». Ce débat vaut pour l’ensemble des pays du monde : comment œuvrer mieux encore à la convergence des luttes de masse (socialistes) et des combats féministes – et antiracistes ?
La construction d’alliances autour de finalités communes, l’élaboration de militantismes inclusifs devraient constituer un atout et une force dans une perspective de lutte contre l’oppression, mais dans la pratique les articulations sont souvent boiteuses, car elles reposent sur une mauvaise compréhension des rapports sociaux de sexe, de classe et de race. Alors que ces rapports de domination sont indissociables, qu’ils sont le produit d’une dynamique complexe et qu’ils se coproduisent mutuellement, ils sont souvent abordés comme des identités séparées et concurrentielles, ce qui amène à basculer dans un schéma de lutte prioritaire versus secondaire. Nombreux sont ainsi les exemples où les revendications féministes ont été effacées devant des luttes généralistes jugées prioritaires. L’autonomie politique des luttes féministes est indispensable, mais cela n’empêche toutefois pas que la perspective féministe soit intégrée dans les organisations anticapitalistes et antiracistes. Le seul impératif est qu’elle le soit comme « une composante stratégique et structurante d’un projet de société émancipateur » (Cisne et Gurgel, 2015).
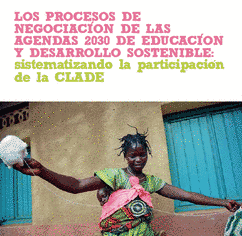
Organizaciones de la sociedad civil reconocen rol inclusivo de la UNESCO en definición colectiva de Nueva Agenda Mundial de Educación
Fuente OREALC 11 de Abril de 2016
El informe emitido por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación sistematiza la actividad de los actores de la sociedad civil en la construcción de la Nueva Agenda Mundial E2030. En este se valora el rol de la UNESCO tanto en la región como a nivel mundial en la inclusión de las voces de los actores educativos en la definición colectiva de las nuevas metas.
En palabras de Camilla Croso, presidenta de la Campaña Mundial por la Educación, «la participación de representantes de la sociedad civil durante las negociaciones de la Agenda de Educación 2030 se sostuvo a lo largo de los años, de manera constante. Fue de fundamental importancia para eso la existencia de la Consulta Colectiva de ONGs para la Educación para Todos (EPT) de la UNESCO, así como la arquitectura democrática del Comité Directivo de la EPT a nivel internacional, además de la inclusión de representantes de la sociedad civil en momentos decisivos de deliberación a nivel regional con ministerios y otras autoridades, sobre las metas educativas. Esperamos que ese dialogo pueda mantenerse también durante la implementación de la agenda».
El rol de la sociedad civil y los movimientos sociales es clave en el debate por el derecho a la educación y será crucial en la nueva agenda mundial. Por esa razón, la OREALC/UNESCO Santiago tendrá un eje de trabajo directo y permanente con los actores sociales en línea con la agenda E2030, a fin de incluir las diferentes plataformas existentes en América latina y el Caribe.

España: La UAL aborda estrategias internacionales de Educación con personal universitario de diferentes países.
www.teleprensa.com/11-04-2016/
ALMERÍA.-El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez y el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, han dado esta mañana la bienvenida a los participantes en la VII International Staff Week, que se celebra hasta el viernes, 15 de abril, en la UAL. El personal docente y administrativo de otras universidades europeas tendrá la oportunidad de conocer el campus universitario almeriense, acercarse al español y participar en diferentes talleres. En su séptima edición, abordarán estrategias internacionales de Educación y situará a Almería en el mapa mundial de los campus universitarios.
Tras la recepción, los asistentes han recibido una charla informal de introducción a la cultura y lengua española, sobre la oficina internacional y otras acciones internacionales. Esta tarde está previsto que hagan una ruta guiada por el centro de la ciudad. Mañana, martes 12 de abril, por la mañana, tras una charla, tendrán la oportunidad de conocer la biblioteca de la UAL y su invernadero tecnológico. Después visitarán Cabo de Gata. Las jornadas del miércoles y jueves se centrarán fundamentalmente en abordar estrategias internacionales de Educación, a través de talleres en los que se hablará de las tendencias y desafíos a los que se enfrentan las universidades. La noche del jueves disfrutarán de una cena con platos típicos almerienses. Ya el viernes, tras la recogida de los certificados de asistencia, cerrarán su estancia en Almería con una visita guiada a la Alcazaba
La séptima edición de la International Staff Week es una firme apuesta del equipo de gobierno de la UAL por abrir sus puertas a estudiantes y docentes de todo el mundo. La Universidad de Almería es elegida cada año por alrededor de medio centenar de estudiantes de unos 30 países diferentes de todos los continentes para llevar a cabo su periodo de movilidad. Estas cifras son el resultado de una larga tradición de cooperación con instituciones de educación superior, no sólo desde Europa a través del programa Erasmus, sino también de América Latina, EE.UU., África y Asia a través programas de movilidad como ISEP, PIMA, o ANUIES CONAHEC.

El significado de la excelencia docente
Por: Blanca Heredia
Un espléndido estudio de Andreas Schleicher, Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: Lessons from around the World, publicado el mes pasado, aborda el tema de en qué consiste y cómo lograr la excelencia docente. El asunto es clave en general y especialmente relevante para México, dados los numerosos indicios sobre las limitaciones de los maestros mexicanos en lo que a calidad docente se refiere.
 Andreas Schleicher
Andreas Schleicher
El trabajo de Schleicher nos ofrece un estado del arte sobre lo que sabemos (y no) en relación a la naturaleza y determinantes de la excelencia docente. El autor comienza señalando que, en el momento actual, un buen docente es aquel que prepara a sus alumnos para enfrentar con éxito los retos y oportunidades planteados por el mundo incierto del siglo XXI. Lo cito:
Los maestros de hoy necesitan preparar alumnos para empleos que aún no han sido creados, para usar tecnologías que no se han inventado todavía y para resolver problemas sociales que no se han presentado en el pasado.
En línea con todo el trabajo desarrollado por Schleicher en educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el punto de partida para evaluar, en este caso a un maestro, tiene que ver con definir un estado de cosas deseable centrado en lo que querríamos les diera a sus alumnos. Un docente excelente, nos propone, es aquel que va más allá de transmitir contenido y consigue desarrollar en sus alumnos la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad para colaborar con otros y las fortaleza de carácter de la que depende la convivencia productiva y civilizada. En suma, Schleicher empieza por donde hay que empezar en cualquier ejercicio de evaluación: definir un estándar compartido a partir del cual evaluados y evaluadores puedan hacer, en efecto, de la evaluación una herramienta para transformar conductas y mejorar resultados.
Uno de los motores de la reforma educativa mexicana iniciada en 2013 es, sin duda, la evaluación de los diversos actores y componentes del sistema educativo. Otro de sus motores, complemento indispensable de la evaluación en el caso de los docentes, es el impulso y renovación de fondo de la formación docente. Es de celebrar que una iniciativa centrada en ello, ambiciosa y mucho mejor fondeada que en el pasado, haya sido anunciada por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, el lunes de esta semana.
Si de lo que se trata es de mejorar la calidad de la educación que reciben en las aulas del país los alumnos mexicanos, urgen muchas y muy variadas cosas. Destaca por su centralidad y urgencia entre ellas, sin embargo, el ofrecerles a los docentes mexicanos recursos de alta calidad y pertinencia para formarse, superar sus deficiencias y desarrollar sus fortalezas, así como para mantenerse actualizados.
Entrarle a este complicado asunto urge. De acuerdo a los resultados de Talis, 2013, encuesta a docentes desarrollada por la OCDE, México es el país con el mayor porcentaje de maestros de secundaria que manifiestan no estar en absoluto preparados para la docencia (ni en contenido disciplinario, ni en métodos pedagógicos) de entre los 34 países y regiones participantes en esa encuesta. Estos datos son consistentes con los resultados de la primera evaluación a maestros en servicio de básica y media superior dados a conocer recientemente y consistentes, también, con los muy pobres resultados de los alumnos mexicanos en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.
El nuevo programa de formación profesional para maestros de básica y media superior anunciado incluye muchos aspectos valiosos entre los que destacan: la elaboración de planes personalizados de formación para cada docente, el apoyo a estos por parte de ATPs, así como una nueva oferta de cursos a cargo de universidades públicas y privadas de alto prestigio.
Del anuncio al hecho hay, evidentemente, mucho trecho y habrá que ver qué tanto de todo lo anunciado logra materializarse y tener los efectos deseados en un tiempo razonable. Más allá de las interrogantes con respecto a la instrumentación, hay un faltante que valdría la pena cubrir a la brevedad. Me refiero a la necesidad insoslayable de hacer explícito el norte, la vara, de todo esto. Es decir: generar una definición clara y compartida sobre qué entendemos por un excelente docente (o dicho como lo puso Marco Fernández en una entrevista reciente: definir con precisión qué significa el que un docente sea evaluado con “insuficiente” o con “destacado”).
Básicamente, pues, para que la celebrable decisión del gobierno de darle a la formación docente una mayor prioridad surta los efectos deseados, esas definiciones resultan indispensables.
Publicado originalmente en: http://www.educacionfutura.org/el-significado-de-la-excelencia-docente/
Imagen destacada: http://www.compartirpalabramaestra.org/etiqueta/incremento-salarial

Miseria en la cultura: decepción y depresión
En 1930 Sigmund Freud escribió su famoso libro El malestar en la cultura y ya en la primera línea denunciaba: «en lugar de los valores de la vida, se prefiere el poder, el éxito y la riqueza, buscados por sí mismos». Hoy día estos factores han alcanzado tal magnitud que el malestar se transformado en miseria en la cultura. La COP-15 en Copenhague nos dio la demostración más cabal: para salvar el sistema del lucro y de los intereses económicos nacionales no se ha temido poner en peligro el futuro de la vida y del equilibrio del planeta sometido ya a un calentamiento que, si no es encarado rápidamente, podrá exterminar a millones de personas y liquidar gran parte de la biodiversidad.
La miseria en la cultura, o mejor, de la cultura, se revela por medio de dos síntomas verificables en todo el mundo: la decepción generalizada en la sociedad y una profunda depresión en las personas. Ambas tienen su razón de ser. Son consecuencia de la crisis de fe por la que está pasando el sistema mundial.
¿De qué fe se trata? Es la fe en el progreso ilimitado, en la omnipotencia de la tecnociencia, en el sistema económico-financiero, con su mercado, que actuarían como ejes estructuradores de la sociedad. La fe en estos dioses poseía sus credos, sus sumos sacerdotes, sus profetas, un ejército de acólitos y una masa inimaginable de fieles.
Hoy día esos fieles han entrado en una profunda decepción porque tales dioses se han revelado falsos. Ahora están agonizando o simplemente han muerto, y los G-20 tratan en vano de resucitar sus cadáveres. Los que profesan esta religión fetiche constatan ahora que el progreso ilimitado ha devastado peligrosamente la naturaleza y es la principal causa del calentamiento global. La tecnociencia que, por un lado, ha traído tantos beneficios, creó una máquina de muerte que sólo en el siglo XX mató a 200 millones de personas y es hoy capaz de exterminar a toda la especie humana; el sistema-económico-financiero y el mercado quebraron y si no hubiera sido por el dinero de los contribuyentes, a través del Estado, habrían provocado una catástrofe social. La decepción está estampada en los rostros perplejos de los líderes políticos, que no saben ya en quien creer y qué nuevos dioses entronizar. Existe una especie de nihilismo dulce.
Ya Max Weber y Friedrich Nietszche habían previsto tales efectos al anunciar la secularización y la muerte de Dios. No que Dios haya muerto, pues un Dios que muere no es «Dios». Nietszche es claro: Dios no murió, nosotros lo matamos. Es decir, para la sociedad secularizada Dios no cuenta ya para la vida ni para la cohesión social. En su lugar entró el panteón de dioses que hemos mencionado antes. Como son ídolos, un día van a mostrar lo que producen: decepción y muerte.
La solución no estriba simplemente en volver a Dios o a la religión, sino en rescatar lo que significan: la conexión con el todo, la percepción de que la vida y no el lucro debe ocupar el centro, y la afirmación de valores compartidos que pueden proporcionar cohesión a la sociedad.
La decepción viene acompañada por la depresión. Ésta es un fruto tardío de la revolución de los jóvenes de los años 60 del siglo XX. Allí se trataba de impugnar una sociedad de represión, especialmente sexual, y llena de máscaras sociales. Se imponía una liberalización generalizada. Se experimentó de todo. El lema era «vivir sin tiempos muertos; gozar la vida sin trabas». Eso llevó a la supresión de cualquier intervalo entre el deseo y su realización. Todo tenía que ser inmediato y rápido.
De ahí resultó la quiebra de todos los tabúes, la pérdida de la justa medida y la completa permisividad. Surgió una nueva opresión: tener que ser moderno, rebelde, sexy y tener que desnudarse por dentro y por fuera. El mayor castigo es el envejecimiento. Se concibió la salud total, y se crearon modelos de belleza, basados en la delgadez hasta la anorexia. Se abolió la muerte, convertida en un espanto.
Tal proyecto posmoderno también fracasó, pues con la vida no se puede hacer cualquier cosa. Posee una sacralidad intrínseca, y límites. Si se rompen, se instaura la depresión. Decepción y frustración son recetas para la violencia sin objeto, para el consumo elevado de ansiolíticos y hasta para el suicidio, como ocurre en muchos países.
¿Hacia donde vamos? Nadie lo sabe. Solamente sabemos que tenemos que cambiar si queremos continuar. Pero ya se notan por todas partes brotes que representan los valores perennes de la condición humana: casamiento con amor, el sexo con afecto, el cuidado de la naturaleza, el gana-gana en vez del gana-pierde, la búsqueda del «bien vivir», base para la felicidad, que es hoy fruto de la sencillez voluntaria y de querer tener menos para ser más.
Esto es esperanzador. En esta dirección hay que progresar.








 Users Today : 17
Users Today : 17 Total Users : 35460708
Total Users : 35460708 Views Today : 32
Views Today : 32 Total views : 3419856
Total views : 3419856